Changement climatique et bioagresseurs : alerte rouge avec les insectes !
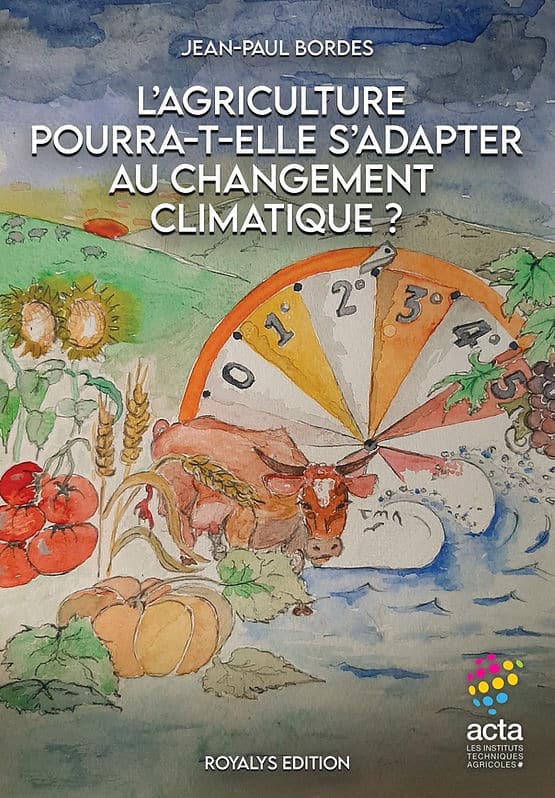
Sous l’effet du changement climatique, les bioagresseurs modifient leurs cycles et leurs zones d’implantation. Pourra-t-on encore protéger efficacement les cultures ? Analyse avec Jean-Paul Bordes, ancien directeur général de l’Acta.
Directeur général de l’Acta de 2018 à 2024, Jean-Paul Bordes vient de publier « L’agriculture pourra-t-elle s’adapter au changement climatique ? ». Il affirme que l’adaptation des pratiques précède la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C’est, selon lui, l’une des premières urgences agricoles pour préserver la production face aux nouveaux équilibres climatiques et biologiques. Mais comment les bioagresseurs réagissent-ils à ces bouleversements ? Et surtout, les agriculteurs disposent-ils des bons leviers pour protéger les cultures ? Entretien.
Pourquoi avoir choisi le thème de l’adaptation au changement climatique ?
Jean-Paul Bordes : Il y a trois raisons. D’abord, parce que c’est l’enjeu majeur de l’agriculture du XXIᵉ siècle avec des implications politiques et géopolitiques. Systémique, il concerne toutes les agricultures du monde, qu’elles soient de plein champ, sous serre, en bio ou conventionnelles. De plus, ce thème touche autant les productions végétales que l’élevage.
Ensuite, le sujet est difficile à appréhender dans sa globalité. La plupart des experts travaille sur une seule ou en tout cas peu de facettes de ce problème : l’eau, le sol, les maladies, les systèmes de cultures, les élevages. Rares sont ceux qui adoptent une vision d’ensemble. Ce manque m’a donné envie d’écrire ce livre.
Enfin, on parle beaucoup de réduction des émissions, mais trop peu d’adaptation. La France ne représente que 0,7 % des émissions mondiales, soit l’équivalent de six mois de la hausse chinoise des gaz à effet de serre ! Évidemment, nos efforts dans les deux voies doivent continuer. En effet, aucune réduction n’est possible sans adaptation.
Constatez-vous un impact visible du changement climatiques sur les bioagresseurs ?
J.-P. B : Oui, c’est incontestable. D’ores et déjà, le changement climatique modifie les équilibres biologiques. De fait, certaines maladies, comme les rouilles du blé colonisent désormais des zones jusque-là épargnées. Surtout, le signal d’alerte principal vient des insectes. Nous sommes dans une situation préoccupante.
Pourquoi les insectes sont-ils l’urgence ?
J.-P. B : Parce qu’ils concentrent toutes les conséquences du réchauffement. En effet, les insectes invasifs se multiplient avec le commerce international. En dix ans, on a recensé plus d’une centaine d’espèces exotiques d’intérêt agronomique sur le territoire. Désormais, le réchauffement favorise leur installation durable et les hivers doux ne jouent plus leur rôle de barrière.
Certains bioagresseurs venus d’ailleurs échappent à tout contrôle, faute d’auxiliaires naturels capables de réguler leur population sur notre territoire. Ainsi, la pyrale du buis, le frelon asiatique, la punaise diabolique et bien d’autres sont dans ce cas.
De surcroît, le front d’attaque des ravageurs se déplace et les populations augmentent. Les pucerons, le carpocapse, la pyrale du maïs et même le taupin enchaînent plus de générations dans leur cycle. Quant à la chenille processionnaire du pin, elle progresse inexorablement vers le nord de la France.
Or, tout cela arrive alors que les insecticides efficaces disparaissent et que les alternatives ne sont pas prêtes. Faute de solutions, des producteurs arrachent leurs vergers ou abandonnent une culture. C’est un vrai risque pour la production française.

Jean-Paul Bordes : « Face au changement climatique et pour contrôler les bioagresseurs, la diversification des cultures deviendra encore plus essentielle dans les décennies à venir ».
Quel serait l’impact pour les champignons et les mauvaises herbes ?
J.-P. B : Pour les maladies cryptogamiques, les effets varient selon les saisons. Par exemple, la septoriose du blé pourraient profiter d’hivers doux et humides pour se renforcer et émerger plus tôt. Mais, les sécheresses printanières risquent aussi de la freiner.
Selon les régions, le profil des maladies pourrait changer mais c’est surtout la variabilité interannuelle qui sera difficile à gérer. Par conséquent, la protection des cultures devra s’adapter à ces fluctuations. Il faudra accepter d’intervenir souvent certaines années et moins d’autres. S’agissant des adventices, le changement climatique joue un moindre rôle. Cependant, on observe déjà des levées plus précoces pour les graminées hivernales comme le vulpin ou le ray-grass. Cette concurrence qui intervient tôt dans le cycle pèse lourd sur le rendement. Néanmoins, le vrai défi reste la réduction du nombre de solutions herbicides et la résistance de certaines espèces.
Comment les agriculteurs peuvent-ils agir alors que leur portefeuille de solutions chimiques diminue ?
J.-P. B : D’abord, la protection des cultures sera multifactorielle. Aucun levier ne suffit seul : il faut combiner agronomie, génétique, phytopharmacie, biocontrôle, numérique et agroéquipements.
En particulier, les rotations, et surtout la diversification, forment les bases de cette stratégie. D’un côté, elles limitent la pression des bioagresseurs inféodés aux cultures. De l’autre, elles sécurisent les exploitations agricoles face aux aléas climatiques et leurs conséquences économiques. Par ailleurs, l’innovation génétique peut être un puissant levier pour lutter contre les maladies, les virus et même les insectes. Des variétés de céréales résistantes permettent de lutter efficacement contre le virus de la jaunisse que le puceron d’automne transmet. Des résistances existent également contre la cécidomyie des fleurs de blé. En revanche, la génétique est moins performante pour concurrencer les adventices.
De même, le biocontrôle, encore limité en grandes cultures, gagne en efficacité lorsqu’il est combiné à d’autres leviers.
Enfin, le numérique complète l’ensemble. Les outils de prévision et de décision guident les interventions au bon moment. Contre les maladies, ils sont particulièrement pertinents du fait de la variabilité annuelle de la pression.
Tout cela s’intègre donc dans une approche systémique. Ainsi, on ne raisonne plus la protection des cultures à la seule échelle de la parcelle. À présent, elle s’envisage à celle de l’exploitation et sur un temps long.
Faudra-t-il trouver d’autres leviers contre les insectes et champignons pour faire face au changement climatique ?
J.-P. B : Effectivement, ils seront multiples. Contre les insectes, aucune solution unique ne se dessine. Certains réagiront aux médiateurs chimiques, d’autres à la régulation naturelle ou à l’introduction d’auxiliaires. On explore aussi d’autres voies comme celle de l’insecte stérile. Pour ce qui est des insectes exotiques, la recherche évalue l’introduction de leur prédateur naturel. Par exemple, l’Inrae expérimente l’adaptation dans les vergers de cerisiers d’une micro guêpe, Ganaspis kimorum, originaire du Japon. L’insecte pond dans les larves de la mouche du fruit, Drosophilla suzukii. D’ailleurs, nous avons réussi à acclimater Torymus sinensis, parasitoïde du cynips du châtaignier. Tous les deux proviennent de Chine.
Toutefois, ces pistes demandent du temps pour l’expérimentation et l’évaluation réglementaire, alors que la pression des insectes s’accélère.
Face aux maladies, la lutte génétique reste prioritaire, bien que les résultats ne soient pas toujours spectaculaires. Par exemple, la recherche développe depuis des années des variétés de blé résistantes aux septorioses. Elle fait des progrès constants mais de faible amplitude. Les NGT pourraient être une voie d’amélioration intéressante mais leur usage fait encore débat.
Enfin, en matière d’adaptation au changement climatique, rappelons une évidence : le premier facteur de résilience, c’est le sol. En outre, un sol vivant, perméable et bien structuré favorise l’exploration racinaire, enrichit la réserve utile. Il offre de bonnes conditions de croissance pour les cultures. Indirectement, il renforce la résistance aux stress climatiques et aux bioagresseurs. Si le sol est sain, la plante a plus de chances de l’être aussi.
Et pour les adventices ?
J.-P. B : Pour celles-ci, la rotation demeure la clé. Si la diversité des cultures dans la rotation couplée à un travail du sol adapté est un levier bien connu, il faut reconnaître que leur mise en œuvre est souvent délaissée. Les mesures préventives donnent rarement des résultats immédiats. Beaucoup d’agriculteurs se laissent encore piéger par la montée lente mais inexorable de flores spécialisées et abondantes. Souvent, elles résistent aux herbicides.
Au fond, le vrai enjeu, c’est l’application des leviers de prévention que nous connaissons. L’inaction en matière de prévention nous expose à des situations ingérables. D’autant plus que la panoplie des herbicides se réduit drastiquement.
Justement, pour qu’une majorité d’agriculteurs modifient leurs pratiques, vous parlez d’innovation frugale. Qu’entendez-vous par là ?
J.-P. B : L’innovation frugale, c’est innover en commençant avec les moyens les plus faciles à mettre en œuvre. Retarder un semis pour limiter les maladies et les adventices, augmenter sa densité pour lutter contre les adventices, introduire une culture de printemps pour casser la dynamique des flores hivernales ou alterner les modes d’action herbicides pour éloigner les risques de résistances : tous ces leviers sont efficaces, accessibles et peu coûteux.
Ainsi, même avec peu de moyens, on peut s’adapter et progresser. Le changement climatique s’inscrit dans la durée : mieux vaut avancer par ajustements successifs que bouleverser tout le système tout de suite.
Et en termes de protection des cultures, quelle est la ligne rouge à ne pas dépasser ?
J.-P. B : Pour moi, la recherche doit disposer de moyens suffisants pour innover. Mais, la réglementation doit laisser le temps aux agriculteurs d’adapter leurs pratiques.
En définitive, le système agricole doit conserver sa cohérence. Une fois brisé, aucun dispositif, même avec la meilleure recherche du monde et les meilleures filières, ne se reconstruit facilement. D’où l’importance de programmes collectifs comme Parsada. Ils ciblent les urgences, soutiennent la recherche appliquée et accélèrent la mise au point de solutions concrètes.
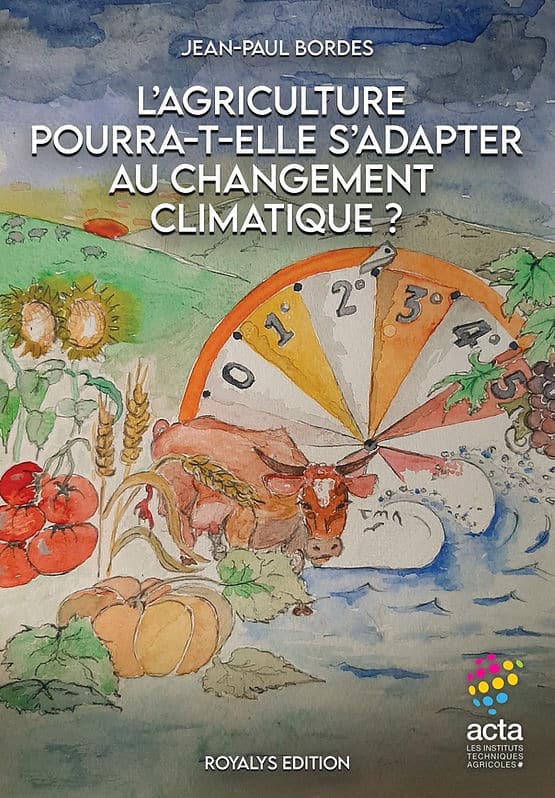
L’agriculture pourra-t-elle s’adapter au changement climatique ?
Par Jean-Paul Bordes
L’ouvrage présente d’abord les multiples paramètres de l’« équation agro-climatique » et leurs interactions complexes. Ensuite, il décrit les impacts du changement climatique sur les grandes cultures et les productions animales en France. La partie centrale explore les leviers d’action et les innovations pour renforcer la résilience agricole. Un chapitre est consacré à l’eau et à l’irrigation, entre solutions et controverses. Enfin, dix annexes et une vaste bibliographie complètent l’analyse.
Éditions Acta et Royalys Éditions
